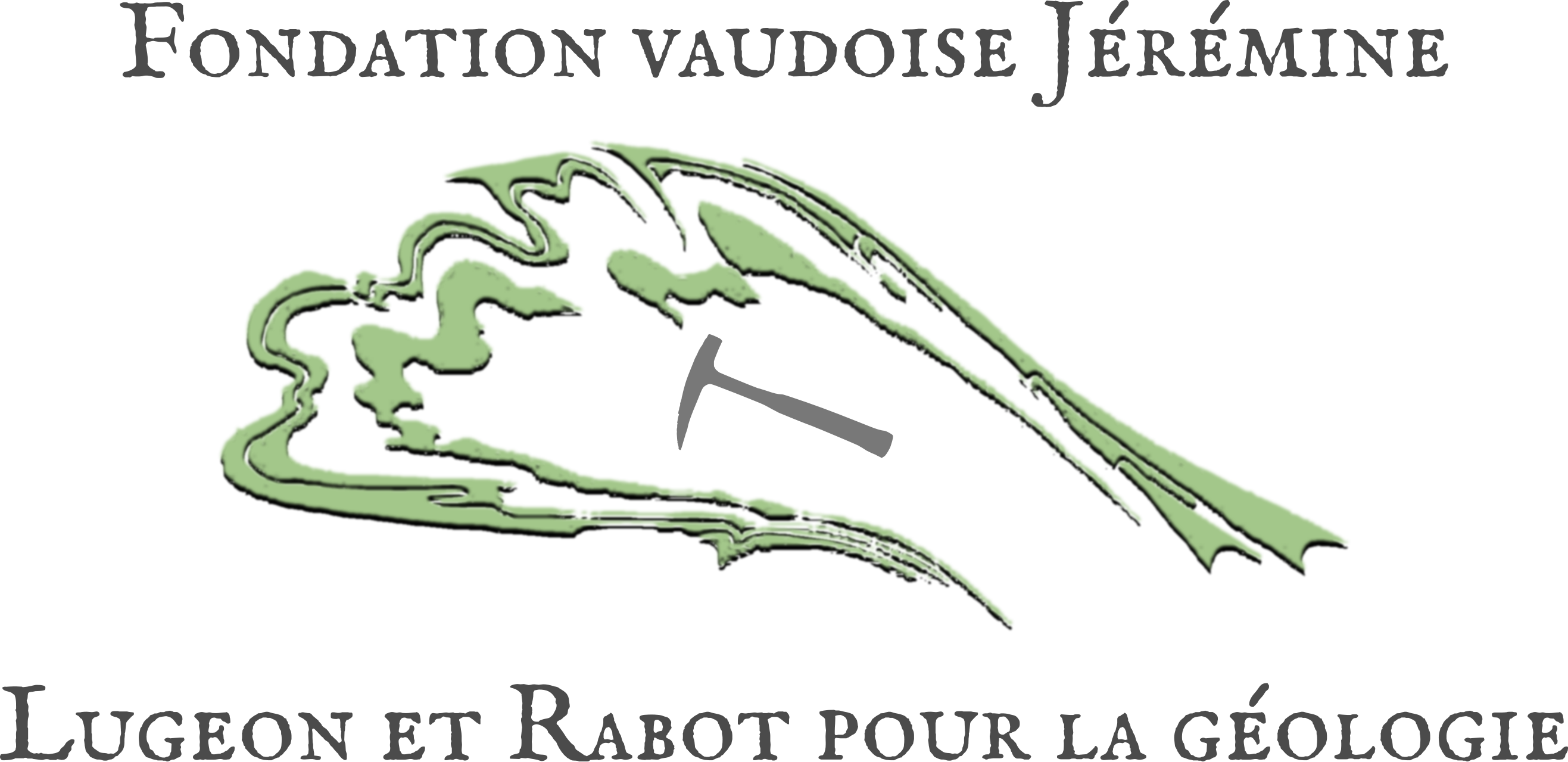Création du Musée géologique vaudois en 1874, il y a 150 ans
par Aymon Baud, directeur honoraire du Musée cantonal de Géologie et chercheur associé à l’Institut de géologie de l’Université de Lausanne.
Introduction
En 1874, une séance de la Commission des Musées se préoccupe d’un manque dramatique d’espace pour les collections du Musée cantonal créé en 1818 et qui se trouvait dans le bâtiment de l’Académie à la Cité. Comme le Conseil d’État venait d’acquérir la maison Gaudard au sud de la Cathédrale, il offrit alors la possibilité de transférer les collections de géologie et le cabinet de botanique dans le premier et le second étage de cette maison.
Dégagé des autres collections de sciences naturelles, le nouveau « Musée géologique vaudois » va enfin avoir une première visibilité. Ceci grâce au professeur Eugène Renevier, au conservateur honoraire Philippe de la Harpe et aux préparateurs qui vont prendre le plus grand soin de ce patrimoine et accueillir de nombreuses et nouvelles collections.
C’est lorsqu’il sera déplacé au Palais de Rumine en 1906, que le musée acquerra alors une réputation internationale.

Mais qui est Eugène Renevier ?
Eugène Renevier, fils de Charles, avocat très réputé, est né le 26 mars 1831 à Lausanne. Sa mère Henriette mourut quand il était enfant. Son père se remaria et s’occupa activement de l’éducation de son fils, qui suivit d’abord le collège à Lausanne puis les cours de l’École polytechnique de Stuttgart, où son père l’avait mis en pension. Il y apprit les rudiments de la géologie de l’époque.


Il y fait la connaissance du jeune Albert Oppel qui a le même âge que lui et qui est passionné de paléontologie. Pendant ses vacances à Lausanne, dès 16 ans, Renevier s’aventure dans les parois du massif des Diablerets pour y chercher des fossiles qu’il emporte à Stuttgart pour faire des échanges avec Albert Oppel, qui lui, avait déjà une très vaste collection et deviendra un paléontologue allemand réputé.
Eugène Renevier: ses études et ses premières publications
À 19 ans déjà, il présente sa première communication à la Société vaudoise des sciences naturelles sur la molasse du Jorat. À 20 ans il s’en va à Genève pour y suivre les cours du paléontologue François-Jules Pictet de la Rive et commence à étudier la géologie de la région des Pertes du Rhône.



En 1854, il se rend à Paris pour suivre les leçons du paléontologue Edmond Hébert et publie avec lui un mémoire important sur la faune Nummulitique des Alpes.
Il rentre définitivement à Lausanne en 1855, armé d’un gros bagage scientifique et précédé d’une juste réputation. Les autorités comprirent tout l’intérêt qu’il y avait à attacher le jeune savant à l’Académie. Dès 1856 il fut chargé d’un cours de zoologie, repris en 1858 par Auguste Chavannes. En 1859, à l’âge de 28 ans, il est nommé professeur extraordinaire de géologie.
Le Musée cantonal et Philippe de la Harpe
Dès le début, Eugène Renevier s’entoure de passionnés de géologie et paléontologie. C’est d’abord, en 1858, le médecin Philippe de la Harpe (1830-1882), qui succède à Charles Lardy comme conservateur des collections de géologie et minéralogie du Musée cantonal, dans le bâtiment de l’Académie.. Mais en 1863, trop occupé, Philippe de la Harpe démissionne de ce poste. C’est alors Eugène Renevier qui, en complément de son poste de professeur extraordinaire, reprend cette activité de conservateur titulaire qu’il gardera jusqu’à son décès, en offrant à Philippe de la Harpe le titre honorifique de conservateur adjoint pour la paléontologie. Très régulièrement, jusqu’à sa mort en 1882, Philippe de la Harpe viendra travailler et étudier au Musée.


Eugène Renevier et les événements durant sa vie d’enseignant
Quatre événements vont marquer les cinquante années d’enseignement du professeur Eugène Renevier :

- L’ouverture à l’Académie d’une Faculté des Sciences indépendante, qui se sépare de Lettres et Sciences en 1869.
- La mise à disposition de locaux pour les collections de géologie et de minéralogie ainsi que pour l’enseignement à la maison Morave ou maison Gaudard (ce dernier nom sera repris au XXe siècle) au sud de la Cathédrale en 1874.
- La création de l’Université de Lausanne en 1890.
- L’ouverture du Palais de Rumine en 1905, avec l’installation de toutes les collections dispersées de géologie, paléontologie et minéralogie et l’ouverture des nouvelles salles d’enseignement, juste avant son décès accidentel en 1906.
Création du Musée géologique à la maison Gaudard
En 1874, l’État de Vaud met à disposition des locaux pour les collections de géologie et de minéralogie ainsi que pour l’enseignement. Ces locaux se situent dans la maison Morave, dite aussi maison Gaudard, située au sud de la cathédrale. Ce bâtiment, dont les premiers éléments datent des XVe et XVIe siècles, avait été acheté et restructuré entre 1671 et 1673 par le lieutenant baillival Gaudard, qui lui avait alors donné à peu près son aspect actuel. La maison resta dans les mains de la famille Gaudard jusqu’en 1780, puis dès 1837, elle hébergea l’Institut morave jusqu’au rachat par l’Etat de Vaud en 1873, d’où ses deux noms.
Renevier obtient aussi d’installer dans cette maison l’auditoire pour l’enseignement de la géologie et de la botanique. Suite à ce transfert, le déménagement des collections va marquer la première phase de la constitution des musées de géologie et de botanique indépendants du Musée cantonal appelé aussi Musée vaudois.

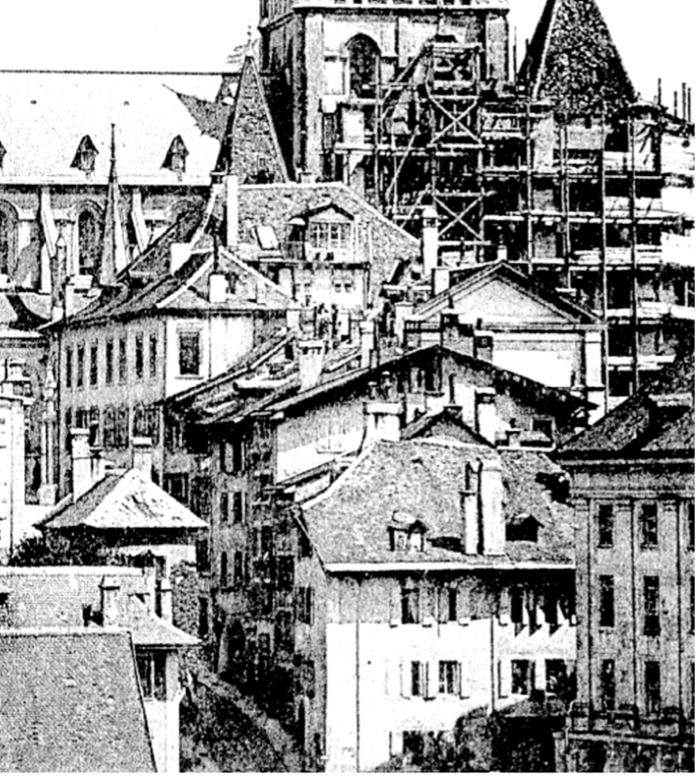

Une coupe transversale montre l’organisation et accès aux étages ici dénommés –rez inf., rez sup., étages et combles. Un escalier en colimaçon permettait, depuis l’entrée à la rue Saint-Etienne no 7, l’accès aux étages avec l’auditoire, les collections et expositions.



Les expositions du Musée de Géologie se trouvaient au 1er et au 2ème étage, côté éclairé. Le premier étage comprenait le local du préparateur et du conservateur avec fenêtres sur la cathédrale et les deux salles de géologie générale et régionale. Au deuxième étage se trouvaient les expositions de paléontologie et de minéralogie ; quant aux réserves, elles étaient au rez (la vue ici date des années 1930 bien après le départ des Musées).
La description des salles d’exposition par Renevier
Ces nouveaux espaces sont ouverts au public en 1880. Renevier décrit en 1894, dans son ouvrage sur le Musée géologique, la disposition des expositions, que nous avons reportée sur les plans d’étage trouvés aux archives cantonales vaudoises (ACV).

Exposition du premier étage
Tout d’abord, au premier étage à droite en entrant :
a) La salle de géologie générale montre les collections de stratigraphie, de roches sédimentaires et de fossiles du Crétacé de la région.
b) Dans la salle de géologie régionale, on trouve les roches et quelques fossiles de nos Alpes, de notre Plateau et de notre Jura.
Exposition du deuxième étage
Renevier décrit également la disposition des expositions du deuxième étage avec la salle de paléontologie à droite en entrant avec les Mammifères fossiles qui sont groupés au centre de la salle. La salle de minéralogie, seconde salle au fonds, comprend la collection générale de Minéralogie, exposée dans douze vitrines, ainsi que les minéraux et roches de l’Oural de la collection donnée par le Tsar Alexandre Ier à Frédéric César De La Harpe.

Eugène Renevier décrit en détail le contenu des deux salles de chaque étage. Ces descriptions se trouvent dans les annexes I et II.
Maurice Lugeon, préparateur du Musée
Maurice Lugeon, alors jeune adolescent passionné par les sciences naturelles, est reçu au Musée en 1882 par G. Leresche, préparateur de botanique, qui lui apprend à déterminer des plantes et des minéraux. Après le départ d’Hermann Goll en 1883, Renevier engage un nouveau préparateur, le jeune naturaliste Théophile Rittener qui travaillait déjà sous sa direction comme collaborateur à des levers géologiques en Savoie. Donc, après Leresche, c’est Rittener qui emmène le jeune Lugeon sur le terrain et lui donne le goût des observations dans lesquelles il va exceller au cours de sa vie entière. Mais les parents de Lugeon, estimant trop coûteuses des études de sciences naturelles, le placent en apprentissage dans une banque de Lausanne.
Pour ses patrons, il est un bien mauvais apprenti car il passe son temps à préparer des étiquettes pour ses collections ou pour son herbier, ou encore à lire, furtivement, des livres de sciences naturelles. Les parents renoncent et par chance en 1886, une place de préparateur au Musée se libère, et la place est proposée à Lugeon qui a alors juste 18 ans et vient de commencer le Gymnase! Passionné, il prépare sa première communication à la Société vaudoise des sciences naturelles sur des plantes fossiles découvertes dans la molasse lausannoise, qu’il présente en séance le 23 janvier 1889.


Le Musée géologique cantonal et ses préparateurs
Mais à partir de 1888, Lugeon est entièrement pris par ses études. Renevier engage alors, pour le remplacer, Charles Bertschinger qui a travaillé́ avec Goll dans les collections du professeur Albert Heim à l’École polytechnique de Zurich et qui travaillera comme préparateur jusqu’en 1893. Lugeon, lui, entre ses cours, va s’occuper de classer les herbiers cantonaux à la demande du professeur Schnetzler. Suite à la maladie puis au décès de Charles Bertschinger en 1893, Renevier engage en 1894, un jeune Suisse émigré à Nîmes, horloger et naturaliste, Henri Lador. Très doué, celui-ci fait une carrière de préparateur tout à fait remarquable au Musée, et y restera jusqu’à son décès en 1932.
Déménagement du cabinet botanique et nouveaux locaux pour l’enseignement et pour le musée de Géologie en 1896

À la suite du déménagement en 1895 du Musée botanique dans un autre bâtiment de l’État à la Cité, la géologie, très à l’étroit dans la maison Gaudard, peut désormais disposer d’espaces supplémentaires et c’est en 1896 que les deux salles libérées sont mises à disposition pour le laboratoire et pour les dépôts du musée. Un nouvel agencement des collections y est organisé avec la création d’un cabinet de travail ainsi que dès 1898, d’une nouvelle salle de travail pour la géologie pratique.
Voilà comment Lugeon en parle plus tard dans ses souvenirs (LUGEON 1940) :
« Ce que, dans l’ambition d’un jeune savant, j’avais appelé, pompeusement, laboratoire de géologie, consistait en une petite chambre humide d’un sous-sol. Pour améliorer la lumière que le ciel essayait de faire pénétrer dans cet antre par deux petites fenêtres donnant sur une rue étroite, j’avais obtenu, après un long rapport justificatif, deux becs de gaz papillon. A chaque fenêtre, il y avait une petite table, au centre une plus grande, contre les murs une bibliothèque bien maigre avec quelques livres achetés au plus bas prix possible chez les antiquaires, quelques chaises cannées, empruntées je ne sais où, de sorte que lorsque l’on était trois ou quatre au travail, c’était l’encombrement et l’on devait se partager au mieux l’espace et la lumière. Mais il régnait dans ce palais de la science l’enthousiasme, la foi, la croyance, l’espérance, la joie, le désir de vivre et la soif d’apprendre. »
Eugène Renevier et Henri Golliez
C’est à un autre géologue, Henri Golliez, jeune ingénieur vaudois formé à l’École polytechnique de Zurich, maître de sciences au collège de Sainte-Croix, membre de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles et qui vient régulièrement au Musée pour des déterminations, que Renevier confie en 1887 une charge de cours de géologie et minéralogie à la Faculté technique, au titre de professeur agrégé. La même année, Golliez est nommé secrétaire général au Département de l’Instruction publique et participe aux négociations de la transformation de l’Académie en une Université moderne.
En 1889, il s’associe avec Maurice Lugeon pour décrire des faunes de tortues découvertes dans de nouveaux affleurements de la molasse dans un chantier de la rue de la Borde à Lausanne. Cette découverte sera présentée dans l’auditoire du Musée Industriel sis à la rue Chaucrau, là où se tiennent les séances de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles.


Eugène Renevier et la nouvelle Université

La transformation de l’Académie en Université de Lausanne, inaugurée en grande pompe en mai 1891, va donner l’occasion d’une grande fête populaire. Pour la géologie, elle amène un nouveau développement avec l’ouverture de deux laboratoires distincts et deux chaires d’enseignement. Le laboratoire de géologie se trouve dans une salle de la maison Gaudard en liaison avec les collections du Musée.
Henri Golliez, professeur à l’École d’ingénieurs et le laboratoire de minéralogie
Comme professeur extraordinaire dans la récemment nommée « École d’ingénieur », Golliez crée le laboratoire de minéralogie qui sera installé, avec celui de zoologie, au no 9 de la place du Tunnel, dans l’immeuble Sollichon loué par l’État de Vaud. Renevier lui fournit des collections du Musée destinées à l’enseignement de la minéralogie et de la pétrographie, ainsi que les livres spécialisés dans cette branche.

Eugène Renevier recteur et Maurice Lugeon professeur
En 1898, suite à la nomination de Renevier comme recteur de l’Université pour deux ans (« Vous aurez à votre tête un Rector fossilis au lieu d’un Rector magnificus » annonce-t-il dans son discours), puis de pro-recteur en 1900, c’est Lugeon qui prend la direction de l’Institut et du laboratoire de géologie avec une part importante de l’enseignement de Renevier, soit la paléontologie et la stratigraphie.
C’est en 1902 que paraissent les 100 pages de synthèse écrites par Lugeon (1902), qui étend les idées développées par Bertrand (1884) puis par Schardt (1893, 1898) et Bertand & Golliez (1897), montrant que le front nord de la chaîne alpine, de la vallée de l’Arve jusqu’à Salzburg, est formé de grandes nappes superposées qui couvrent complètement le vrai front autochtone, caché en profondeur. Cette synthèse, étendue jusqu’aux Carpates puis aux Tatras en Pologne par Lugeon et Termier, lors du Congrès géologique international de Vienne en 1903, va opérer une vraie révolution dans les sciences géologiques et régir durablement la compréhension de toute la tectonique alpine.
La maîtrise géologique montrée par l’École de Lausanne acquiert une réputation internationale, et les nouveaux étudiants attirés par Renevier et Lugeon, tels Emile Argand, Alphonse Jeannet et Ferdinand Rabowski vont, par leurs travaux, étendre cette réputation dans les domaines de la tectonique globale et de la paléontologie.
1905 : l’ouverture du Palais de Rumine et le déménagement du musée
Pour la géologie lausannoise, 1905 est une année très importante. C’est d’abord l’arrivée de ces nouveaux étudiants qui viennent préparer leur thèse en géologie à Lausanne. Avec eux, l’impact de Lausanne sur les sciences de la terre va s’amplifier à l’échelle suisse et européenne ! C’est aussi la fin du chantier du Palais de Rumine et le début du déménagement des laboratoires, des Musées scientifiques et de la Bibliothèque cantonale. Le transfert des collections de la maison Gaudard au Palais de Rumine est supervisé par Renevier, assuré par Lugeon avec le préparateur Lador et les nouveaux assistants, Argand, Jeannet et Rabowski.
Le 3 novembre 1905, le Palais de Rumine s’ouvre aux cours de l’Université.


1906 : Le décès d’Eugène Renevier
Le 5 mai 1906, Renevier chute accidentellement chez lui dans une cage d’ascenseur ouverte et décède le lendemain, soit dix jours avant la fête organisée pour le cinquantième anniversaire du début de son enseignement à l’Académie et la remise du titre de docteur honoris causa de l’Université de Genève, qui se fera à titre posthume. À la demande de Lugeon, la grande salle d’exposition consacrée à la géologie et la stratigraphie, qui vient d’être agencée dans le Palais de Rumine, va porter le nom de « Renevier », gravé sur le fronton d’entrée. L’autre grande salle consacrée à la paléontologie, portera le nom de « De la Harpe », lui aussi gravé. Par sa persévérance et un travail constant, Renevier réussit en une quarantaine d’années à faire passer un petit cabinet géologique, placé au sein d’un musée du début du XIXème siècle, à un grand musée des sciences géologiques, indépendant et de réputation internationale, superbement logé dans le Palais de Rumine dès 1906.
Article plus détaillé: La mort stupide d’Eugene Renevier
Conclusion
Comme l’écrit en 1912 Henri Blanc, professeur de zoologie, dans son ouvrage « Historique du musée zoologique », à propos de la séparation des musées en 1874 : « Un grand bien devait encore résulter de cette nouvelle organisation ; elle permettait à nos musées d’avoir le personnel utile dont ils avaient le plus pressant besoin, aussi prirent-ils dès cette époque un nouvel essor ».
Il est intéressant de noter que cette séparation des musées et cette nouvelle organisation de 1874, si nécessaire à leur développement, ont été curieusement occultées dans le livre « Le Musée cantonal 1818-2018 » publié en 2021 et en particulier dans le chapitre rédigé par Nicolas Gex « Entre enseignement et recherche. Le Musée d’histoire naturelle comme lieu de savoir (1870-1940) », alors qu’il ne s’agissait pas d’un seul musée d’histoire naturelle, mais bien de trois musées cantonaux distincts, soit de botanique, de géologie et de zoologie.

Par rapport à la pléthore en Suisse de musées d’histoire naturelle, musée que chaque ville d’importance possède, le Canton de Vaud avait le privilège et l’originalité de disposer de trois musées bien distincts qui collaboraient et offraient chacun leurs prestations bien ciblées à un public demandeur. Or en 2022, le Conseil d’État a validé la création d’un « Muséum cantonal des sciences naturelles » et a placé une direction unique à sa tête, gommant ainsi les musées cantonaux de botanique, de géologie et de zoologie, réduits à l’état de départements au sein du nouveau « Naturéum ». Cette solution onéreuse est -elle un progrès ? L’avenir nous le dira.
Bibliographie
Baud, A. (2019). L’enseignement académique de la géologie à Lausanne de 1832 à 1906 : Eugène Renevier et les naturalistes géologues. Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles, vol. 98, 159-197 (ISSN 0037-9603).
Bertrand, M. 1884. Rapports de structure des Alpes de Glaris et du bassin houiller du Nord. Bulletin de la Société Géologique de France (3), 12, 318-330.
Bertrand, M. et Golliez, B. 1897. Les chaînes septentrionales des Alpes bernoises. Bulletin de la Société Géologique de France, 3, 568-595.
Blanc, H. (1912). Le Musée zoologique de Lausanne : ses origines – son installation au Palais de Rumine – ses collections. Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles, vol. 48, 71-124
Collectif d’auteurs (2021). Le Musée cantonal, 1818-2018. Histoires et enjeux des musées encyclopédiques. Bibliothèque-Historique-Vaudoise, vol. 150, 1-208.
Gex, N. (2021). Entre enseignement et recherche. Le Musée d’histoire naturelle comme lieu de savoir (1870-1940). In Le Musée cantonal, 1818-2018. Bibliothèque-Historique-Vaudoise, vol. 150, 79-92.
Golliez, H., & Lugeon, M. (1889). Note sur quelques Chéloniens nouveaux de la mollasse langhienne de Lausanne Compte-rendu de la SVSN du 19 juin 1889, 12
Lugeon, M. (1902). Les grandes nappes de recouvrement des Alpes du Chablais et de la Suisse: Bulletin de la Société géologique de France, 4, 723-825.
Lugeon, M. (1903) Les nappes de recouvrement de la Tatra et l’origine des Klippes des Carpathes. Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles 39 :17-63.
Lugeon, M. (1949). 100 ans de géologie vaudoise. Suisse contemporaine, vol. 7-8, 13-22.
Renevier, E., (1894). Notice sur l’origine et l’installation du musée géologique de Lausanne. Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles, vol. 30. 199-208
Renevier E. & Golliez H. 1894. Les Alpes centrales et occidentales. Livret-guide géologique dans le Jura et les Alpes de la suisse dédié au Congrès géologique international 6ème session à Zurich. Payot Lausanne. 197-235.
Robert, O. & Pavese F., (2000): Dictionnaire des professeurs de l’Université de Lausanne dès 1890. Université de Lausanne, Etudes et documents, vol. 36.